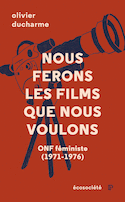Nous ferons les films que nous voulons
| Aussi disponible en version numérique: |

Une plongée dans une série novatrice de films féministes produits par l’ONF au milieu des années 1970. Quand les enjeux d’hier résonnent encore aujourd’hui.
Nous sommes en 1971, à l’Office national du film du Canada (ONF). Des femmes – cinéastes, scénaristes, monteuses, actrices, productrices, camerawomans – se réunissent. De cette rencontre naît un groupe et une série féministe : En tant que femmes. De cette série naîtront six films, documentaires et fictions, produits de 1972 à 1975, et qui se veulent « une recherche de l’identité de la femme québécoise », lit-on dans les publications de l’ONF sur la série.
Six thèmes, six situations, six films : la valeur positive de l’amour dans la vie des femmes (J’me marie, j’me marie pas); le malaise de celles qui n’ont d’existence qu’en fonction de leur mari et de leurs enfants (Souris, tu m’inquiètes); la responsabilité maternelle et familiale via le problème des garderies (À qui appartient ce gage?); les rôles que la société d’hier et d’aujourd’hui a dévolus à la femme et la dégradation de son image (Les Filles du Roy); l’appartenance à un groupe et le besoin de relations humaines des adolescentes (Les filles c’est pas pareil); la solitude de la femme devant l’avortement et la contraception dans un monde qui n’invite plus à la maternité (Le temps de l’avant).
Six films, six thèmes, mais surtout une interrogation constante. Chaque film, loin de toute idéologie plaquée, privilégie l’interrogation à l’affirmation. On ne dit pas aux femmes comment vivre, quoi faire. On les invite plutôt à remettre en question le monde dans lequel elles vivent; à regarder, à l’intérieur et à l’extérieur d’elles, ce qui les empêche d’être libres. Car la seule affirmation que la série revendique, de rappeler l’auteur, est la liberté pour chaque femme de choisir la vie qu’elle souhaite mener. Les six films forment un kaléidoscope en forme de questions. Chacun des six films agence des formes et des couleurs uniques qui composent, une fois réunies, une représentation plurielle de l’identité des femmes québécoises du début des années 1970. Sous l’impulsion de femmes cinéastes qui font figures de pionnières telles que Anne Claire Poirier et Jeanne Morazain-Boucher, un important travail de recherche en amont permettra de dégager des thèmes, des préoccupations, des traits communs qui conduisent à la production de la série.
Si pour une grande majorité du grand public ces films sont aujourd’hui tombés dans l’oubli, il ne faudrait pas sous-estimer l’importance qu’ils ont eu en leur temps. C’est d’ailleurs le grand mérite de l’essai d’Olivier Ducharme, qui nous replonge dans cette époque et de nous fait voir les grands enjeux que soulevait cette série de six long-métrages. Enjeux qui, pour certains, trouvent encore aujourd’hui une grande résonance.
C’est de cette richesse thématique et de l’impact qu’a eu la série sur la société québécoise que rend compte Olivier Ducharme, avec l’aide de moult témoignages de l’époque, dans une nouvelle plongée historique dont l’essayiste québécois a le secret.

Olivier Ducharme est chercheur au Collectif pour un Québec sans pauvreté. Auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie et le cinéma, il a notamment publié, chez Écosociété, À bout de patience (2016), Travaux forcés (2018), Ville contre automobiles (2021) et 1972 : répression et dépossession politique (2022).
NB : Les prix indiqués sont sujets à changements sans préavis.